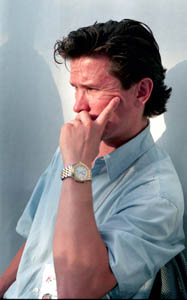

Bykov and Khomutov links:
- Bykov's Bio at "People" (in Russian)
- Khomutov's Bio at "People" (in Russian)
- A recent interview with Andrey (in Russian)
- Homecoming: Slava is the new CSKA head coach! (in Russian)
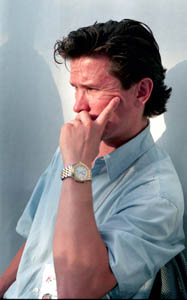 
|
Bykov and Khomutov links:
|
Vyacheslav Bykov naît le 24 juillet 1960 à Chelyabinsk. Il pratique le ski de fond jusqu'à quinze ans, et courir et skier dans la forêt lui donnent le goût de l'effort. Mais sa passion naissante, c'est le hockey. Pour les gamins du quartier, c'est alors une distraction parmi d'autres, qu'ils affectionnent toutefois au point de récupérer des sapins de Noël jetés après les fêtes afin de s'y découper des crosses, inventant le recyclage avant l'heure.
Le petit Bykov chausse ses premiers patins vers huit ans, à Kalibre, équipe d'une compagnie d'armement où joue son oncle. Si sa famille a peu de moyens, son père, tailleur mis à la retraite par une pneumonie, lui est parfois utile pour raccommoder son équipement. Sur la glace, Slava Bykov compense sa petite taille, héritée de son père, par son agilité. Habitué à être le plus petit, il apprend l'évitement, la vitesse et la passe, et développe en lui les qualités qui font la gloire du hockey soviétique, axé sur la construction du jeu. Sur des patins, il se sent plus léger. Sa rapidité et sa couverture de la glace en font un joueur de centre.
Certains se découvrent une vocation en lisant Pouchkine ou Tolstoï. Plus matheux pour ce qui est de ses études, Bykov fait son éducation avec Tarasov sur sa table de chevet... Anatoli Tarasov, le père fondateur du hockey soviétique, le créateur du système du CSKA, dont il a acheté le livre lors d'un voyage à Ekaterinbourg.
Ingénieur ou hockeyeur, l'heure du choix
Dans toutes les équipes de jeunes, Bykov fait ligne commune avec son ami Aleksandr Belenov, mais leurs routes se séparent à dix-huit ans alors que chacun doit faire un choix cornélien. Ils jouent tous deux dans l'équipe de l'Institut d'Agronomie, l'école technique de la ville, et disputent de nombreuses compétitions où ils sont des buteurs remarqués. Le Traktor Chelyabinsk, club dont l'équipe première est la fierté de tous les habitants, les invite dans son équipe junior pour la finale du championnat national. L'opportunité ne se refuserait pas un seul instant si le directeur de l'Institut ne s'y était pas fermement opposé, ne croyant pas à la reconversion sportive tardive des deux compères et mettant leur renvoi dans la balance. Il faut choisir entre une carrière d'ingénieur, qui permet d'être exempté de service militaire, ou un avenir incertain de hockeyeur. De ces deux jeunes joueurs au talent comparable, un seul opte pour le hockey sur glace envers et contre tout : Slava Bykov.
Dans ce tournoi final, il affronte avec fierté des internationaux juniors et des espoirs reconnus comme Krutov, et sa ligne est la meilleure de son équipe, alors que certains de ses coéquipiers avaient déjà été champions de Russie des moins de seize ans. Il n'est pas chassé de l'Institut pour autant, le directeur s'étant dédit, mais est recruté par l'équipe senior du Metalurg Chelyabinsk, club de deuxième division. L'entraîneur Piotr Dubrovin décèle déjà chez ce frêle joueur de centre un grand potentiel, puisqu'il le place d'emblée en première ligne. Il termine la saison avec cinquante buts - un de moins que son ailier Boris Molchanov - et est invité par le grand Traktor pour les trois rencontres qu'il reste à disputer dans la saison. Presque un intrus parmi les grands, Slava marque un but par match. Un an plus tôt, il était un obscur joueur d'une équipe scolaire, sans sélection nationale junior. Lui qui n'avait jamais été considéré parmi les meilleurs joueurs du pays ni même de sa ville s'ouvre à vingt ans les portes de l'équipe senior du Traktor Chelyabinsk, alors le septième meilleur club d'URSS.
Petit et sans complexes
Et il n'occupe pas n'importe quelle place. Pour cette nouvelle saison 1979/80, le coach Guennadi Tsygurov l'aligne au centre du premier bloc, avec à sa droite Valeri Belousov, bientôt grand entraîneur. Chacun se rend vite à l'évidence, un nouveau génie du hockey est apparu à Chelyabinsk. Qu'a-t-elle donc, cette morne ville industrielle, pour enfanter tant de hockeyeurs de renom ? Ce n'est pas que soit née ici une race de géants. Comme Makarov avant lui, Bykov ne mesure que 1m72 et n'a pas de prédispositions génétiques évidentes pour le hockey sur glace, simplement un formidable tempérament. Son talent ne s'explique pas, tout comme ses adversaires ne s'expliquent pas comment il a pu leur voler le palet ou les mettre en déroute de manière si imprévisible. C'est que Bykov ne fait aucun complexe, même face aux grandes vedettes du hockey soviétique. Gai et sympathique, il s'impose comme le leader du Traktor, aussi bien sur que en dehors de la glace, dans les meilleurs comme dans les pires moments.
Dès sa première saison complète, Slava est le meilleur marqueur du Traktor et est convoqué par Viktor Tikhonov au CSKA Moscou, porte d'entrée vers l'équipe nationale. Mais il ne se sent pas prêt et décide de rester une année de plus à Chelyabinsk, notamment par solidarité avec ses compagnons de ligne trentenaires. Comme dans le hockey soviétique tout fonctionne par blocs, ils risqueraient une retraite anticipée en cas de départ de leur centre. Cette seconde saison est tout sauf une perte de temps pour Bykov, puisqu'il en profite pour épouser Nadia. Même son bras dans le plâtre, conséquence d'un coup de crosse tchèque lors du tournoi de Leningrad réservé aux équipes nationales B, ne remet pas en question la date de la cérémonie. Il faut dire que Slava doit profiter au maximum de ces moments d'intimité, ils seront rares dans le club de l'armée sous la férule de Tikhonov et de sa discipline de fer.
Bykov n'est pas le premier joueur de Chelyabinsk happé par le CSKA, et si cet exode laisse un goût amer au Traktor, il a au moins un avantage pour Slava : il trouve un clan tout prêt à l'accueillir dans le club moscovite, ce qui l'aide moralement à supporter les charges de travail colossales imposées par Tikhonov et ses préparateurs physiques. C'est Sergueï Makarov, dont le frère Nikolaï a joué avec Slava au Traktor, qui l'héberge à son arrivée à Moscou, même si six jours sur sept se passent de toute manière à la base d'entraînement. Il trouve tout de même le temps d'avoir une fille, Macha, qui naît en août 1983 pendant que Slava joue la Coupe d'Europe. Mais il ne la verra que deux mois et demi plus tard, lorsque le CSKA ira jouer à Chelyabinsk, et fait alors rapatrier sa petite famille dans un appartement de deux pièces au centre de Moscou, authentique privilège consenti au camarade hockeyeur...
Accusé de vol à Stockholm
L'intégration en équipe nationale est une nouvelle réussite. Dès sa première sélection contre la Tchécoslovaquie à Prague, Slava Bykov, mis en confiance par l'ancien Shalimov, inscrit un but et une assist. Pourtant, alors qu'il a joué ses premiers championnats du monde en 1983, sa carrière internationale connaît un coup d'arrêt à cause d'une affaire extra-sportive. Lors des déplacements à l'étranger, il était de coutume de donner de l'argent de poche aux joueurs pour qu'ils puissent acheter à leurs parents et amis les marchandises qu'on ne trouvait généralement pas en Union Soviétique. Au cours d'une heure de shopping de ce type pendant une tournée en Suède en décembre 1983, Bykov déclenche la sonnerie d'un portique et est aussitôt accusé d'avoir voulu voler des vêtements. Il essaie de bafouiller quelques mots d'anglais pour expliquer qu'il avait l'intention de payer, mais qu'il ne savait pas que la caisse était à l'étage et non à la sortie, ayant évidemment assez peu l'expérience des grands magasins.
Néanmoins, le mal est fait. Le temps qu'il se fasse comprendre, il a raté l'avion et créé un scandale. La presse occidentale se jette sur l'affaire et dénonce le malheur de ce Soviétique éberlué par les richesses de l'ouest et obligé de voler pour habiller son fils. À cause de cette histoire qui prend une tournure politique, le pauvre Bykov subit même un interrogatoire du KGB à son retour à Moscou, car il est soupçonné d'être un espion à la solde de l'Occident. C'est le très influent Tikhonov qui le sort de ce guêpier, faisant ainsi en sorte que son joueur lui soit encore plus redevable, et donc dévoué corps et âme. Bykov est néanmoins suspendu par sa fédération et rate ainsi les Jeux Olympiques de 1984. Viktor Tikhonov décide même de ne pas non plus le sélectionner pour la Coupe Canada quelques mois plus tard, sans lui fournir d'explications.
Dans l'ombre de la KLM
L'absence de Bykov passe relativement inaperçue car le monde du hockey n'a d'yeux que pour la KLM, la ligne magique des années 80. Bykov est considéré à l'étranger comme un joueur comme un autre, un de ces Russes supposés interchangeables et sans personnalité. Pourtant, son jeu est vraiment digne d'attention. Le détail frappant chez Slava, c'est sa crosse plus grande que lui. Choisir un bâton aussi long est atypique, mais cela lui accorde une grande maîtrise de l'espace. Sa science du placement est complétée par une glisse phénoménale, ce à quoi il ajoute cette improvisation créatrice qui désarçonne les défenses.
Notre stratège des patinoires fait peu à peu son chemin, et se construit un bloc. On lui trouve un ailier, Andrei Khomutov et son accélération phénoménale, puis un autre, Valeri Kamensky, puissant joueur formé à Voskresensk et d'abord orienté uniquement vers le but avant d'être éduqué tactiquement par ses nouveaux compagnons. Pour sa quatrième année comme international, Bykov est donc le centre de la deuxième ligne. Tikhonov le teste même sur la première à la place d'Igor Larionov, mais ses partenaires demandent à rester dans la même composition. En URSS, les joueurs vont par cinq, et il est hors de question de toucher au super-bloc.
Heureusement, il est tout de même possible de briller dans son ombre. On ne l'affronte pas deux fois par jour aux entraînements quotidiens sans progresser. Dans le championnat soviétique, l'adversaire déploie souvent toute son énergie pour museler la KLM, et la ligne de Bykov effectue alors le travail pour affirmer la domination implacable du CSKA. Au niveau international, les recettes anti-KLM sont moins évoluées, mais aux championnats du monde 1989, c'est Vyacheslav Bykov qui doit débloquer la situation dans une victoire décisive 1-0 contre la Tchécoslovaquie.
Quand les premiers hockeyeurs sont autorisés à passer à l'ouest, Bykov et Khomutov ont un geste de bonne volonté envers Tikhonov, leur tyran. Celui-ci a vu ses ouailles dociles lui tourner le dos, et c'est son empire qui s'effondre. Il se raccroche alors à Bykov et Khomutov, qui acceptent de rester en échange d'un bon de sortie la saison suivante. Slava est élu nouveau capitaine à l'unanimité par ses coéquipiers, aussi bien en club qu'en sélection, mais la charge de succéder à Fetisov est une lourde responsabilité. Brutalement privé de sa première ligne toute entière, le CSKA est presque une proie facile, que le Dinamo si longtemps frustré s'empresse de détrôner. Vyacheslav Bykov doit se racheter avec l'équipe nationale. La saignée y est moins franche car Fetisov et Makarov sont de retour. C'est d'ailleurs Bykov lui-même qui les a appelés au téléphone, à la demande de Tikhonov, que les circonstances ont forcé à découvrir les rapports humains - et à reconnaître que d'autres se débrouillent mieux que lui en la matière. L'URSS, que l'on disait en fin de règne, reste pourtant championne du monde en 1990, en Suisse, un pays dont Slava sait déjà qu'il est sa prochaine destination.
Deux stars en Suisse
En effet, Bykov et Khomutov délaissent les contrats proposés par les Nordiques de Québec, qui les ont draftés un an plus tôt. Après la vie de caserne au CSKA, Slava veut découvrir le monde, pas redevenir l'otage - même grassement payé, d'un autre système, celui de la NHL. Il recherche de la proximité et des contacts humains. Avec son complice Khomutov, ils jettent leur dévolu sur la Suisse, ce petit pays neutre dont ils n'ont encore qu'une image floue, digne d'une carte postale. C'est ainsi que deux des meilleurs joueurs de la planète estomaquent le monde du hockey en atterrissant à Fribourg-Gottéron. Ce choix est incompris, au Canada où on trouve inconcevable que l'on puisse préférer un club suisse à la NHL, en Russie où l'on craint qu'ils perdent leur niveau de jeu dans un championnat aussi faible, et même en Suisse où tout le monde se pince en entendant la nouvelle. 1990, la date est historique, et Bykov portera désormais le n°90, en lieu et place du n°27 qui était le sien au CSKA et en équipe nationale.
Slava ouvre grand ses yeux et ses oreilles, il vit pleinement son aventure helvétique. Contrairement au taiseux Khomutov, il apprend très rapidement le français. Bykov apprend, et il enseigne aussi. À son contact, ce ne sont pas seulement ses coéquipiers, c'est tout le hockey suisse qui progresse. Mais il y a une chose qu'il ne parviendra jamais à faire évoluer, ce sont les mentalités des hockeyeurs locaux. Lui qui a été élevé dans le culte de la victoire et l'abhorration de la défaite - et ce ne sont pas des vains mots au CSKA - ne parviendra jamais à s'y faire, entendre des joueurs rire et chanter au soir d'une défaite lui reste en travers de la gorge. Mais pour un Suisse, un échec n'a jamais signifié un jour de permission en moins auprès de sa famille, ou des heures de préparation physique en plus, au bout de la souffrance. Ce choc culturel est impossible à résorber. Malgré tout leur talent, Bykov et Khomutov ne pourront pas insuffler à leurs coéquipiers leur rage de vaincre, et Gottéron ne sera jamais champion, malgré trois finales.
Locomotive de la sélection
Le duo se rattrapera donc avec l'équipe nationale, dont il est désormais la colonne vertébrale. Ils répondent en effet toujours présent à l'appel de la sélection, Bykov s'en explique : "C'est un sentiment patriotique. Ou plutôt, ce n'est pas seulement l'amour de mon pays natal, c'est l'amour du hockey. L'amour est désintéressé. Aujourd'hui, la relation à l'équipe nationale rentre dans une logique plus financière."
Aux JO d'Albertville 1992, qui se disputent pendant la saison NHL, Bykov encadre la nouvelle vague avec Khomutov. Il marque le dernier but de la finale, celui qui coupe les jambes des Canadiens, et obtient sa deuxième médaille d'or olympique pour le compte de l'éphémère équipe de la CEI (Communauté des États Indépendants). Nouveau changement de maillot en 1993, où Bykov porte pour la première fois les couleurs de la Russie. En demi-finale, il fait face à Eric Lindros, le rookie multi-millionnaire de la NHL, et remporte ce duel de façon éclatante, pas décisif vers un dernier titre de champion du monde.
C'est peut-être cette gifle infligée à l'homme que tous les Canadiens francophones détestent (Lindros les avait méprisés et avait refusé de se rendre à Québec qui l'avait sélectionné en n°1 de la draft) qui explique que les Nordiques reviennent à la charge. Même s'il a pris de l'âge, Bykov est maintenant intéressé par cette nouvelle expérience, mais il ne veut pas y aller pas sans Khomutov. Or, son collègue est plus réticent. En outre, Québec commet l'erreur de ne parler que d'argent à Slava, alors que ce n'est pas sa priorité. Bykov ne jouera donc jamais en NHL.
Renvoyer l'ascenseur
Il passe au total sept saisons à Fribourg-Gottéron et y marque plus de deux points par match, mais en 1998, la non-reconduction de son contrat intervient de façon inattendue pour lui et le fait beaucoup souffrir. Il évite le déracinement à sa famille en terminant sa carrière avec Lausanne en Ligue Nationale B. Le 18 août 2000, un jubilé est organisé pour lui à Fribourg, à guichets fermés, entre une équipe de Gottéron renforcée et une sélection de stars russes de NHL comme Bure ou Yashin. À deux minutes de la fin de ce match de bienfaisance, Slava fait entrer sur la glace son fils Andrei, douze ans. Renato Tosio, le gardien qui a gagné le respect éternel de son père depuis un arrêt incroyable sur la ligne au tournoi des Izvestia, le laisse marquer deux buts.
Slava pourrait maintenant se la couler douce dans sa belle villa avec piscine de Marly, mais s'il y a une expression française qu'il a appris en Suisse, c'est qu'il faut "renvoyer l'ascenseur". Autrefois, au CSKA, il avait appris des anciens et légué son savoir aux nouveaux, mais cette tradition s'est perdue dans la Russie moderne où on ne s'investit plus dans la formation des jeunes. En Suisse, on y attache au contraire de plus en plus d'importance. Bykov tient avant tout à enseigner aux enfants et n'est pas pressé de s'occuper d'une équipe senior, mais il s'y met quand Fribourg-Gottéron a besoin de lui au mois de janvier 2003.
By Marc Branchu
Sources: Hockey Archives and All about Hockey